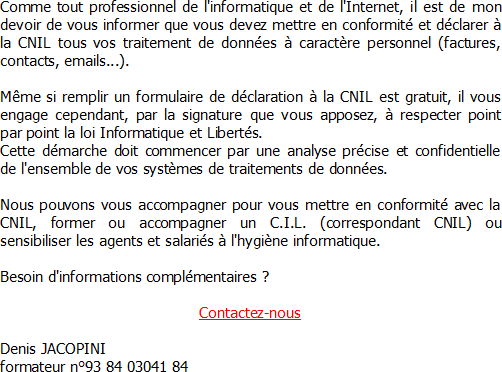Utilité et conformité des mesures de blocage de sites Internet faisant l’apologie du terrorisme dans le cadre de l’état d’urgence.
 |
Utilité et conformité des mesures de blocage de sites Internet faisant l’apologie du terrorisme dans le cadre de l’état d’urgence. |
| A ce jour, il existe certains exemples de moyens, usités par les terroristes, permettant de contourner une mesure de blocage d’un site, notamment, l’utilisation d’un « Virtual Private Network » (Réseau Privé Virtuel).
Ce dernier établi un réseau fictif, reliant un ordinateur (celui du client VPN) à un serveur (le serveur VPN), afin de permettre une connexion à Internet de manière anonyme.
De cette façon, les échanges de données sont cryptés et sont protégés par des clés de chiffrement. De plus, ce système permet d’utiliser une adresse IP différente de celle réellement utilisée par un ordinateur, ce qui complique considérablement la localisation de cette machine. De même, le logiciel « Tor » permet de se connecter à Internet par le biais de serveurs répartis dans le monde dans l’anonymat. Il convient de noter que ces procédés cryptologiques sont parfaitement légaux, effectivement, l’article 30 de la loi LCEN du 21 juin 2004 érige en principe que « l’utilisation des moyens de cryptologie est libre ». Dès lors, peut-on envisager l’introduction d’un contrôle par l’autorité administrative, sous forme d’autorisation préalable, lorsque l’utilisation de tels procédés est faite à des fins de provocation au terrorisme ?
Enfin, ces mesures de blocage de sites peuvent sembler illusoires étant donné que celles-ci ne s’appliquent qu’à des FAI et hébergeurs situés sur le territoire français. D’autant que de telles mesures drastiques ne sont pas exemptes de risques de « surblocage ». En 2013, l’Australie a pu en faire les frais en bloquant par accident 250 000 sites sur sa toile.
En conséquence, loin d’être la panacée, cette nouvelle disposition, faussement pragmatique, semble foncièrement superfétatoire.
Sur la conformité de la loi par rapport au bloc de constitutionnalité ? A titre liminaire, il importe de se poser la question de savoir si la loi du 20 novembre 2015 est susceptible d’être déclarée non conforme à la constitution compte tenu de l’absence de consécration constitutionnelle du statut de l’état d’urgence. A cette fin, il conviendra d’appliquer mutatis mutandis le raisonnement adopté par le Conseil Constitutionnel dans deux décisions : celle du 10 juin 2009 concernant la loi HADOPI et celle relative à la loi sur la pédopornographie du 10 mars 2011.
Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil en raison du caractère disproportionné du blocage et de sa contrariété avec l’article 11 de la DDHC censure la loi HADOPI soumise à son contrôle « considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ».
En substance, les Sages expliquent que l’octroie par la loi à une autorité administrative du pouvoir de suspendre l’accès à internet est une entorse à la « la libre communication des pensées et des opinions ». L’autorité administrative n’ayant pas le statut de juridiction, elle ne peut se voir octroyer ce pouvoir exorbitant de bloquer un site illicite.
A rebours, dans sa décision du 10 mars 2011, les Sages valident l’article 4 de la loi Loppsi 2 permettant de procéder au blocage administratif de sites pédopornographiques « considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l’autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d’internet, l’accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l’autorité administrative est susceptible d’être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la liberté de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
Dans cette décision, la mesure de blocage est déclarée conforme à l’article 11 de la DDHC de 1789 au motif qu’il existe un recours au fond ou en référé des décisions de blocage et qu’il est consacré un objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (ici l’exploitation sexuelle des mineurs). En ce qui concerne la conformité du nouveau dispositif, il est à noter que ce nouvel article 11 de la loi de 1955 énonce que « le ministre de l’Intérieur peut prendre toute mesure » de blocage de sites faisant l’apologie du terrorisme. La large marge d’appréciation laissée à l’exécutif amène à s’interroger sur le caractère proportionné de cette disposition. Ainsi, un parallèle peut être opéré avec l’article L. 336-2 du CPI prévoyant des mesure de blocage en cas de violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin. Celui-ci met en évidence l’éventuel caractère excessif du nouveau dispositif. Si ce dernier rend possible « toutes mesures », l’article L. 336-2 du CPI autorise seulement « toutes mesures propres » en vue de bloquer un site.
La référence au principe de proportionnalité, tangible dans cet article du CPI, ne l’est pas en ce qui concerne cette nouvelle mesure. Dans le cadre d’un raisonnement analogue à celui employé dans la décision du 10 juin 2009, on peut appréhender une potentielle censure par les Sages. En effet, la loi du 20 novembre 2015, compte tenu de sa rédaction large et générale, peut habiliter le ministre de l’Intérieur à « restreindre ou à empêcher l’accès à Internet ». De ce fait, un accroc à l’article 11 de la DDHC peut être redouté. D’ailleurs, le rapporteur au Sénat énonçait que « la disposition proposée [la loi lopssi 2] présente une portée beaucoup plus restreinte [que la loi HADOPI] puisqu’elle tend non à interdire l’accès à internet mais à empêcher l’accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite ». Ainsi, le nouveau texte de 2015 risque de connaître le même sort que celui donné à la loi HADOPI, en ce que rien n’interdit au ministre de l’Intérieur de prendre des mesures bloquant l’accès à un site sans pour autant bloquer un site en particulier. Par ailleurs, une autre incertitude juridique semble planer sur cette loi du 20 novembre 2015 au regard de la décision du 10 mars 2011. S’il est vrai que la suppression du délai de 24 heures ne semble pas impacter la conformité de ce texte, il en va autrement de l’éviction du rôle de contrôle de la CNIL. En effet, l’article 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle ». Auparavant, la loi de 2014, chargeait la CNIL d’assurer ce rôle de gardien a posteriori, c’est-à-dire, en actionnant en aval les recours nécessaires devant la juridiction compétente. De même, la CNIL détenait la faculté de contrôler le bien fondé des demandes de retrait de l’autorité administrative. La nouvelle loi éludant cet encadrement exercé par la CNIL, peut laisser sceptique sur sa conformité au texte constitutionnel. D’autant que la loi ancienne (de 2014) n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, que ce soit de manière a priori ou a posteriori, devant le Conseil Constitutionnel !
Sur le risque de contrariété de la loi avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme ? Dans un récent arrêt CEDH du 1er décembre 2015, la Cour censure des mesures de blocage de sites pratiquées par le gouvernement turc. En l’espèce, les autorités turques avaient ordonné le blocage de Youtube en raison de dix vidéos accusées de faire outrage à la mémoire d’Atatürk, fondateur de la République laïque turque. Des mesures de blocage ont été ordonnées entre 2008 et 2010. La Cour reconnait une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice des droits garantis par l’article 10 de la convention portant sur la liberté d’expression. De la même façon, la loi de novembre 2015 n’excluant pas la possible coupure d’un site Internet, elle encourt le risque d’être déclarée disproportionnée au regard de l’intérêt légitime poursuivi, à savoir, la lutte contre l’apologie du terrorisme. Toutefois, l’article 15 de la CEDH autorise dérogation aux obligations de cette convention dans une situation d’état d’urgence, excepté pour les principes non dérogeables, dont ne fait pas partie l’article 10 de la CEDH. Mais un prolongement durable de l’état d’urgence posera nécessairement une difficulté relative à sa compatibilité avec l’article 15 de la CEDH. A moins, (ce que le gouvernement envisage) d’établir un socle juridique solide de l’état d’urgence, au sein de la constitution. En conséquence, de lege lata, la conformité de ce nouveau dispositif semble loin d’être évidente au regard d’un certain nombre de droits fondamentaux garantis. Somme toute, est-ce qu’« à force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel » ? (Edgar Morin)
|